Le secteur de l'Énergie traverse une transformation profonde. Entre la transition énergétique, la digitalisation des opérations, et les nouvelles réglementations imposées par la CRE, les systèmes d'information deviennent des enjeux stratégiques pour tous les acteurs. Les projets de transformation digitale portent des risques considérables : dérivesbudgétaires, retards de plusieurs mois, voire échecs complets qui peuvent impacter durablement la performance opérationnelle.
Fort de 15 ans d'expérience auprès de RTE, GRDF, Enedis et des producteurs d'énergies renouvelables, Abrennis structure vos projets de transformation digitale dès l'amont : appels d'offres conformes, pilotage contractuel, optimisation TMA.
→ Découvrez notre expertise complète : Contract Management et Pilotage de Projets ERP pour le secteur de l'Énergie
Sommaire de l'article :
- Le paysage des acteurs de l'énergie en France
- Les enjeux majeurs des projets de transformation digitale
- Les exigences techniques du secteur énergie
- Cas d'usage typiques dans le secteur de l'énergie
- Notre approche opérationnelle
Le paysage des acteurs de l'énergie en France
Le secteur de l'Énergie français a connu de profondes mutations ces dernières décennies. L'ouverture à la concurrence et la transition énergétique ont fait émerger de nouveaux acteurs aux côtés des opérateurs historiques qui continuent de structurer le marché.
Les acteurs historiques du Secteur Public
Les grands opérateurs historiques gèrent les infrastructurescritiques, assurent une part importante de la production d'énergie, et sont soumis à une réglementation stricte de la CRE ainsi qu'au code de la commande publique.
Les Entreprises Locales de Distribution (ELD) constituent un ensemble d'acteurs historiques locaux qui gèrent la distribution d'électricité et/ou de gaz sur des territoires circonscrits dans le cadre de concessions. Les principales ELD sont Électricité de Strasbourg, Gaz et Électricité de Grenoble, et Bordeaux Métropole Énergies. Ensemble, les ELD représentent environ 5% du marché de la distribution d'énergie en France et desservent près de 2 500 communes. Leur proximité territoriale leur confère une connaissance fine des besoins locaux, mais elles font face aux mêmes défis de modernisation des systèmes d'information que les grands opérateurs nationaux.
Ces acteurs partagent des contraintes communes : obligation de service public, contrôle strict de la CRE, procédures d'appels d'offres en marchés publics, et gestion de systèmes d'information critiques gérant des millions de clients.
Les producteurs d'énergies traditionnelles et renouvelables

Au-delà des opérateurs historiques, le paysage de la production d'énergie combine des acteurs établis de longue date et de nouveaux entrants focalisés sur les énergies renouvelables. Si l'hydroélectricité a historiquement structuré ce secteur, d'autres sources d'énergie traditionnelles (thermique, nucléaire) ont également donné naissance à des acteurs historiques. L'essor de l'éolien et du solaire a ensuite fait émerger une nouvelle génération de producteurs.
Les nouveaux acteurs évoluent dans un cadre réglementaire différent des opérateurs historiques : sociétés privées, elles ne sont pas soumises au code de la commande publique mais doivent respecter les exigences d'injection dans les réseaux et de traçabilité de la production imposées par les gestionnaires.
Les opérateurs de bornes de recharge électriques

Le programme Advenir joue un rôle structurant dans le développement de ce marché. Cette subvention finance jusqu'à 50% du coût d'installation des bornes de recharge dans certains contextes (flottes professionnelles, copropriétés, parkings publics), ce qui accélère considérablement le déploiement des infrastructures. Les systèmes d'information de ces
opérateurs doivent gérer non seulement la supervision des bornes et la facturation au kWh, mais également les dossiers de demande de subvention Advenir et le suivi des financements obtenus.
Cette diversité d'acteurs crée une complexité considérable dans les projets de transformation digitale. Les contraintes ne sont pas les mêmes selon qu'on gère une infrastructure critique de service public ou qu'on développe des projets d'énergies renouvelables en tant qu'acteur privé.
Les enjeux majeurs des projets de transformation digitale
Souveraineté et sécurité des données

Le secteur de l'Énergie traite des données hautement sensibles : les données de consommation énergétique révèlent les habitudes de vie des citoyens. Ces informations, collectées par les compteurs Linky et Gazpar, nécessitent une protection maximale.
La contrainte réglementaire nécessite souvent un stockage des données dans l'Union Européenne pour respecter le RGPD. Certains opérateurs, particulièrement les acteurs publics gérant des infrastructures critiques, vont parfois plus loin en exigeant un hébergement strictement en France. Cette exigence plus restrictive découle de considérations de souveraineté nationale et de la directive NIS applicable aux opérateurs d'importance vitale.
Les datacenters utilisés sont souvent dédiés au secteur de l'énergie, voire propriétaires de l'entreprise elle-même. Cette architecture garantit un cloisonnement maximal et limite les risques de compromission. La certification SecNumCloud, délivrée par l'ANSSI, devient de plus en plus exigée dans les appels d'offres des grands opérateurs publics pour les solutions de cloud privé.
Les projets de transformation digitale doivent donc intégrer dès la conception ces contraintes d'hébergement et de sécurité. Le choix des solutions cloud, des datacenters, et des prestataires doit être compatibles avec ces exigences sous peine de devoir tout revoir en cours de projet.
Choix technologiques et vision long terme
Les décisions technologiques prises lors d'un projet de transformation digitale dans le secteur de l'énergie engagent l'entreprise pour une durée moyenne de 20 ans. Cette durée exceptionnellement longue, comparée à d'autres secteurs où les cycles technologiques sont plus courts, s'explique par plusieurs facteurs : l'ampleur des investissements (jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros pour un déploiement ERP complet), la complexité des migrations (risque opérationnel majeur sur des processus critiques), et la rareté des fenêtres de tir pour mener de tels projets.
Cette perspective de deux décennies impose une réflexion stratégique approfondie sur plusieurs dimensions.
- La solution choisie doit-elle répondre uniquement au besoin actuel ou anticiper les évolutions réglementaires et métier des prochaines années ?
- Quelle est la trajectoire d'évolution de l'éditeur et sa pérennité financière ?
- La solution est-elle suffisamment modulaire pour absorber des changements majeurs sans tout remettre en cause ?
L'évolutivité de la solution devient un critère de choix déterminant. Une architecture rigide nécessitera des développements spécifiques coûteux à chaque évolution réglementaire imposée par la CRE, tandis qu'une architecture flexible permettra d'absorber ces changements par un simple paramétrage. Le maintien de la documentation technique et fonctionnelle tout au long de ces 20 ans constitue un défi organisationnel majeur : les équipes tournent, les prestataires changent, et la mémoire collective se dilue. Sans documentation rigoureusement maintenue, la complexité de la solution devient ingérable.
La propriété intellectuelle du code source est une autre particularité et qui présente deux dimensions critiques. D'abord, disposer en permanence d'une copie du code source : dans certains cas, le code n'est présent que chez le prestataire et ne peut être récupéré que sur demande, ce qui crée une dépendance dangereuse.
Ensuite, être juridiquement propriétaire de ce code : les développements spécifiques doivent appartenir à l'entreprise et non au prestataire. Cette situation est moins problématique pour les Opérateurs d'Importance Vitale qui disposent généralement de leurs propres serveurs sur lesquels travaillent les prestataires, permettant un accès direct au code à tout moment. Dans tous les cas cette accessibilité facile du code source constitue un élément fondamental pour maîtriser son système d'information, ce qui est capital pour ce type d'entreprise. Le dépôt de codes sources auprès de l'Agence de Protection des Programmes (APP), que nous savons piloter, apporte une sécurité juridique complémentaire en plus du contrat.
Enfin, la capacité à organiser une réversibilité à tout moment, particulièrement lors du passage d'un prestataire de Tierce Maintenance Applicative (TMA) à un autre, doit être préservée. Des clauses de réversibilité détaillées et des procédures de transfert de compétences formalisées sont indispensables pour éviter les situations de blocage.
🎯 Vous lancez un projet ERP dans l'énergie ?
La propriété intellectuelle, la réversibilité et la documentation pérenne sont des enjeux critiques trop souvent négligés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Découvrez comment structurer ces aspects dès le premier jour du contrat.
→ Lire notre analyse : Réversibilité ERP : la préparer et anticiper la propriété intellectuelle
Conformité marchés publics et réglementation
Les grands opérateurs publics sont soumis au code de la commande publique. Toute consultation dépassant les seuils européens doit faire l'objet d'une publicité dans le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) et le JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne). La mise en concurrence doit être transparente, avec des critères de sélection objectifs annoncés dès le lancement.
La rédaction du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) est un exercice juridique complexe. Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) doit décrire précisément le besoin sans avoriser un prestataire particulier tandis que le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) fixe les conditions d'exécution, de paiement et de pénalités. Le moindre vice de procédure peut entraîner un recours et l'annulation de la consultation après plusieurs mois de travail.
Structurer un DCE conforme tout en sécurisant vos intérêts opérationnels nécessite une double expertise : juridique sur le code de la commande publique, et technique sur les spécificités des projets ERP/EAM secteur énergie. Chez Abrennis, nous sécurisons juridiquement vos consultations en amont et vous accompagnons dans la rédaction de DCE qui protègent vos intérêts tout au long de l'exécution.
📋 Besoin d'accompagnement sur la structuration de votre appel d'offres ?
Découvrez notre méthodologie éprouvée : Guide complet pour réussir votre appel d'offres ERP
Les exigences techniques du secteur de l'énergie
Processus métiers du domaine de l'électricité et réglementations spécifiques

Le secteur de l'électricité en France présente des spécificités héritées à la fois du monopole historique d'EDF et des évolutions réglementaires européennes et nationales. Les systèmes d'information doivent intégrer ces particularités pour être conformes.
Gestion des réseaux de distribution : Enedis et les ELD gèrent 1,5 million de kilomètres de lignes électriques en France. Les systèmes doivent gérer les raccordements, les interventions de dépannage, la maintenance préventive, et le suivi des incidents. La collecte des données de comptage Linky (35 millions de compteurs communicants) génère des volumes massifs de données à traiter quotidiennement.
Gestion des réseaux de transport : RTE pilote 100 000km de lignes haute tension et assure l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en temps réel. Les systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) surveillent le réseau en continu et les outils de prévision anticipent les besoins futurs. Ces applications critiques nécessitent une disponibilité
absolue.
→ Pour plus de détail sur le réseau de distribution et de transport voir l'article LinkedIn : Quand tout le monde parle de panneaux solaires mais que personne ne regarde les lignes hautes tension
Équilibre offre-demande : L'électricité ne se stockant pas, l'équilibre entre production et consommation doit être maintenu en permanence. En France c'est qui RTE coordonne les moyens de production et peut imposer des délestages de consommation en cas de contraintes techniques pour éviter une coupure généralisée, bien que ces situations restent rares.
Les systèmes d'information gèrent à la fois une dimension de pilotage opérationnel et une dimension de facturation, car les mécanismes d'ajustement, de capacité, et d'effacement sont contractualisés avec les acteurs du marché. L'effacement, contrairement au délestage qui est subi, fait notamment l'objet de contrats spécifiques où des consommateurs acceptent de réduire leur consommation en période de tension moyennant rémunération ou avantage.
Mécanismes réglementaires spécifiques français : L'ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) oblige EDF à céder une partie de sa production nucléaire à prix régulé à ses concurrents. Les systèmes de facturation doivent intégrer ce mécanisme. Les taxes comme la CSPE (Contribution au Service Public de l'Électricité) et la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) constituent des paramètres que les systèmes d'information doivent pouvoir prendre en compte.
Certains mécanismes réglementaires français sont parfois inspirés des pratiques d'autres pays européens. Par exemple, le dispositif d'abattement sur le TURPE pour les sites électro-intensifs a été mis en place en France sur le principe de ce qui existait Allemagne, afin de favoriser la compétitivité des entreprises industrielles fortement consommatrices d'électricité.
Plus d'informations sur le dispositif TURPE pour les électro-intensifs.
Ces spécificités réglementaires changent peu dans leur nature, mais les seuils et taux associés peuvent varier chaque année, ce qui impose aux systèmes la capacité de faire évoluer facilement ces paramètres sans nécessiter de développements lourds.
Spécificités du gaz et calcul des consommations
Le secteur du gaz présente une particularité technique majeure dans le calcul de la facturation. Contrairement à l'électricité où l'énergie est mesurée directement en kWh, la consommation de gaz est relevé en volume (m³) mais facturé à l'énergie consommée (kWh). Une conversion nécessite de prendre en compte le pouvoir calorifique du gaz, qui varie selon la provenance et la
composition du gaz injecté dans les réseaux.
Avec l'injection croissante de biométhane issu de sources décentralisées (méthaniseurs agricoles, stations d'épuration), le pouvoir calorifique moyen peut varier sensiblement d'un point d'injection à l'autre d'un jour sur l'autre. Les systèmes d'information doivent donc calculer la facturation en appliquant des coefficients de conversion spécifiques à chaque zone de distribution et à chaque période. Cette complexité dépasse les capacités standard des ERP du marché et nécessite des développements spécifiques ou des moteurs de calcul dédiés.
L'injection de biométhane nécessite également une traçabilité précise pour le calcul des primes versées aux producteurs, la génération des certificats de production de gaz renouvelable, et le reporting réglementaire à la CRE.
ERP Métier et solutions de gestion d'actifs
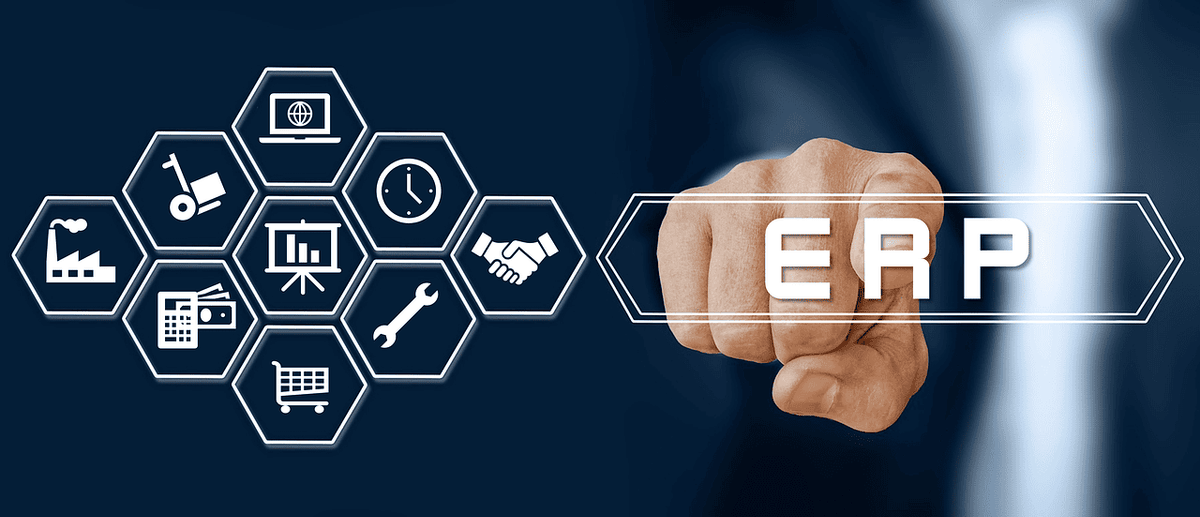
Les grands opérateurs historiques (EDF, RTE, Enedis, GRDF, Engie, GRT Gaz et Terega) ont déployé des solutions ERP pour gérer leurs processus de facturation, de comptabilité, d'achats, et de gestion des stocks. Ces systèmes sont en place depuis de nombreuses années et font l'objet d'évolutions continues pour s'adapter aux changements réglementaires imposés par la CRE. Les processus métier couverts incluent la facturation multi-énergies avec application des tarifs régulés, la gestion de la relation client, et la gestion financière.
Pour la maintenance des infrastructures physiques (réseaux, postes électriques, canalisations), plusieurs solutions EAM (Enterprise Asset Management) sont utilisées notamment : Maximo d'IBM, Infor EAM, SAP EAM,et IFS Applications. Ces outils permettent de planifier la maintenance préventive, de gérer les interventions correctives, et de tracer l'historique complet des actifs. Abrennis possède une expertise particulière sur ces solutions de gestion d'actifs.
Cas d'Usage dans le secteur de l'énergie
Mise en Place d'un Centre de Services
La centralisation du support applicatif et de la maintenance évolutive constitue une évolution fréquente pour les grands pérateurs qui ont déployé des applications métier sur plusieurs périmètres. La création d'un centre de services unifié permet de rationaliser le support et standardiser la qualité de service.
Le centre de services est généralement constitué d'un mix d'équipes internes (recrutement de profils permanents) et d'équipes externes (prestataires sélectionnés via appels d'offres). Cette organisation hybride permet d'avoir un socle stable de compétences internes complété par des
ressources externes modulables selon la charge.
Le tableau ci-dessous présente les principales fonctions métier supportées par un centre de services dans le secteur de l'énergie. Cette liste n'est pas exhaustive mais représente les processus les plus demandés. D'autres fonctions, comme les ressources humaines, sont souvent gérées dans des TMA dédiées.
Le cahier des charges doit définir précisément le périmètre fonctionnel adapté aux métiers de chaque acteur. Par exemple, la gestion des réseaux de distribution ne concerne que les distributeurs (Enedis, GRDF, et les ELD), tandis que la comptabilité est commune à tous les opérateurs. Les outils de support doivent être paramétrés pour router automatiquement les demandes vers les équipes compétentes selon la nature métier de la demande.
Le pilotage de la mise en place nécessite généralement 3 à 6 mois selon la taille du centre de services, avec parfois une organisation par vagues ou par lots cohérents pour limiter les risques de la transition. Les résultats sont mesurables : amélioration de 30% du temps de résolution grâce à une meilleure coordination et une capitalisation sur les incidents récurrents, en particulier sur la gestion de bout en bout des incidents (par sollicitation d'un seul titulaire au lieu de plusieurs).
Appels d'offres et pilotage de marchés AMOA
Les projets de refonte des systèmes d'information nécessitent souvent des compétences d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les équipes métier. Ces profils interviennent principalement en support de la gestion des évolutions applicatives et surtout pendant la phase de recette fonctionnelle : rédaction des scénarios de test, exécution des tests, validation de la conformité métier.
Dans le cadre des marchés publics, il est courant d'avoir des marchés à bons de commande structurés avec des tarifs établis par profil et une mise en concurrence pour chaque besoin spécifique. Cette spécificité des contrats publics permet de disposer d'un panel de prestataires qualifiés tout en préservant la concurrence au fil des commandes. Le marché peut être structuré en lots par domaine fonctionnel pour couvrir les différentes expertises métier.
Déploiement d'outils de support et gestion des incidents
Le remplacement des outils de gestion des incidents constitue un projet structurant. L'appel d'offres est généralement organisé avec l'intégrateur proposant les licences éditeur, ou l'éditeur proposant l'intégration.
Le projet nécessite de reprendre l'historique des tickets ouverts, de recréer les interfaces, et de former les utilisateurs. Les processus s'appuient généralement sur les bonnes pratiques ITIL (gestion des incidents, demandes, changements, problèmes).
La période de migration nécessite généralement 6 mois pour aboutir à un outil opérationnel offrant une meilleure traçabilité.
Passage en TMA avec hypercare
Le passage d'un projet ERP à la Tierce Maintenance Applicative nécessite un accompagnement personnalisé plutôt qu'un basculement brutal. Abrennis préconise une phase d'hypercare d'une durée minimale de 3 mois après le Go Live, à ajuster suivant la complexité de la solution mise en oeuvre.
Pendant la phase d'hypercare, l'équipe est constituée deréférents issus du projet et de référents issus de la TMA, représentant au total environ 50% des effectifs globaux des deux équipes. Ces référents assurent la résolution accélérée des incidents de stabilisation, le support rapproché des utilisateurs, et les ajustements de paramétrages nécessaires.
Le transfert de compétences s'effectue via une documentation applicative complète, des sessions de formation pratiques, et des binômages entre les référents projet et TMA. Notre approche consiste à piloter cette transition avec une gouvernance rapprochée pendant les 6 premiers mois pour garantir la stabilisation et l'optimisation des coûts (réduction typique de 20-30%).
💡 Optimisez vos contrats de TMA dès maintenant
La transition vers la TMA est un moment clé pour renégocier vos conditions contractuelles et optimiser vos coûts de run. Notre approche permet une réduction documentée de 20 à 30% des coûts tout en améliorant le niveau de service.
→ Découvrez notre savoir-faire : Notre expertise secteur de l'Énergie et nos prestations en Contract Management dédiées aux projets ERP dans l'Energie.
Optimisation par l'offshore francophone
L'optimisation des coûts de support et de TMA par un passage en offshore s'oriente plus naturellement vers des destinations francophones pour les entreprises uniquement implantées en France. La maturité de l'offshore dans ces zones s'est considérablement développée ces dernières années, avec des effectifs dédiés aux services IT qui se chiffrent désormais en dizaines de milliers de professionnels qualifiés.
Le fuseau horaire proche ou identique facilite la coordination avec les équipes en France et permet une couverture étendue des horaires de support. La Tunisie et le Maroc bénéficient d'une maturité offshore particulièrement élevée, avec des écosystèmes IT bien structurés et une offre
de formation continue qui alimente le vivier de compétences.
Le cahier des charges doit spécifier les exigences linguistiques et prévoir les modalités de transfert de compétences sur 3 à 6 mois. Les résultats sont au rendez-vous lorsque la transition est bien pilotée: réduction de 25 à 35% des coûts avec maintien voire amélioration du niveau de
service grâce à des profils qualifiés.
Un point d'attention majeur concerne la gestion du turnover, qui varie fortement selon des facteurs locaux : le pays, la ville (capitale vs villes secondaires), l'entreprise concernée, et le mode de management pratiqué. Un turnover élevé peut éroder rapidement les compétences transférées et dégrader le niveau de service. La sélection du prestataire offshore doit donc intégrer une évaluation de sa capacité à retenir les talents sur la durée.
Conclusion : sécuriser vos projets de Transformation Digitale dès l'amont
Les projets de transformation digitale dans le secteur de l'énergie cumulent des contraintes que peu de cabinets maîtrisent réellement. Souveraineté des données avec hébergement France ou UE, cycles d'engagement de 15 à 20 ans, conformité au code de la commande publique pour les opérateurs publics, exigences métier hautement spécialisées (TURPE, ARENH, CSPE, calculs de facturation gaz, intégrations SCADA), et volumétries critiques (35 millions de compteurs Linky, 30 millions de clients électricité).
Mais ces contraintes, correctement anticipées et structurées dès l'appel d'offres, deviennent des leviers de différenciation et de performance durable plutôt que des sources de crise contractuelle.
L'approche Abrennis : structurer en amont, pas gérer les crises
Contrairement aux cabinets qui interviennent en mode pompier lorsque les tensions contractuelles sont déjà installées, nous sécurisons la gouvernance dès la phase d'appel d'offres.
Échangeons sur votre projet de transformation digitale
Vous lancez un projet ERP ou EAM ? Vous structurez un appel d'offres en marché public ? Vous renégociez vos contrats de TMA ? Vous devez organiser une réversibilité ?
Nos publications sur le secteur de l'Énergie :
- L'essor des bornes de recharge en France : acteurs et perspectives
Analyse du déploiement des infrastructures de recharge, du programme
Advenir, et des modèles économiques des opérateurs. - L'essor des gaz Verts : un enjeu économique, écologique et social
État des lieux de la filière biométhane en France, des mécanismes de
soutien public, et des perspectives de l'hydrogène vert. - Le Photovoltaïque : innovation, agrivoltaïsme et recyclage
Tendances 2025 du solaire photovoltaïque : innovations technologiques,
agrivoltaïsme, et enjeux du recyclage.
Parcourez nos ressources par niveau d'expertise
Que vous découvriez le Contract Management ou que vous cherchiez une expertise pointue sur un projet spécifique, nos articles sont organisés en 4 niveaux pour vous guider efficacement.
📘 Niveau 1 : Découvrir les fondamentaux
Vous débutez ou souhaitez une vision synthétique ? Commencez ici.
📗 Niveau 2 : Approfondir les concepts
Vous voulez comprendre comment ça marche concrètement ? Plongez dans ces articles.
📕 Niveau 3 : Expertise métier
Vous pilotez un projet spécifique ? Ces guides sectoriels et métier vous donnent les clés.
- Projets ERP et transformation digitale : → Guide complet : Réussir son appel d'offres ERP : Méthodologie en 2 temps (éditeur puis intégrateur), contractualisation, pièges à éviter
- Maintenance et gestion d'actifs : → Guide EAM : Choisir sa solution de gestion d'actifs : Best of Breed vs solutions intégrées, maintenance prédictive, ROI
- Secteur de l'énergie : → Réseau électrique français : état des lieux et trajectoire 2025-2040
📙 Niveau 4 : Outils & Ressources
Besoin d'une définition, d'un modèle ou d'un outil ? Consultez nos ressources.
À propos de l'auteur
Alain Boyenval est le fondateur du cabinet Abrennis, spécialisé en Contract Management et pilotage de projets ERP pour le secteur de l'énergie.
Fort de 20 ans d'expérience auprès des grands opérateurs français — RTE, EDF, Enedis, GRDF — il a piloté des projets de transformation digitale représentant plusieurs dizaines de millions d'euros : déploiements SAP IS-U, mise en place de centres de services, structuration d'appels d'offres en marchés publics.
Son passage chez Arcwide (joint-venture BearingPoint/IFS) lui a permis d'accompagner les nouveaux acteurs de l'énergie : producteurs photovoltaïques, opérateurs de bornes de recharge, producteurs de biométhane.
Expertise clé : Contract Management, SAP IS-U, IFS Cloud, Maximo, TMA, appels d'offres ERP, secteur énergie.
Mis à jour le 23 décembre 2025